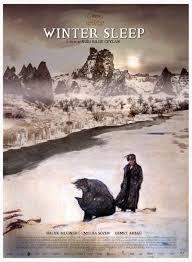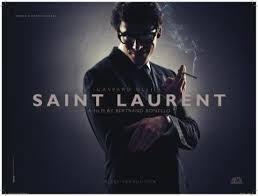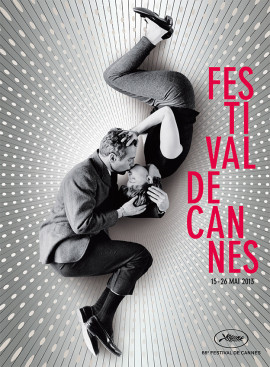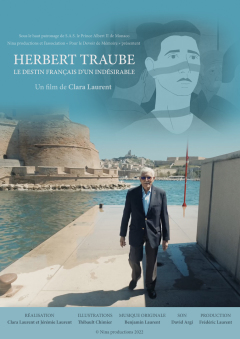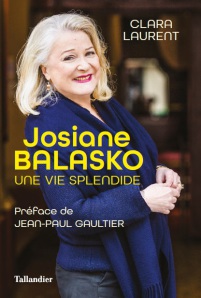SOMMAIRE DE LA RUBRIQUE "Festival de Cannes"
- CANNES 2015: Une nouvelle sur la voix de Jean-Louis Trintignant, par Natacha Milkhoff
- CANNES 2014 - Article 3: Winter sleep, de Nuri Bilge Ceylan
- CANNES 2014 - Article 2: Mommy, de Xavier Dolan
- CANNES 2014 - Article 1 : Saint Laurent, de Bertrand Bonello
- La Vie d'Adèle, Abdelattif Kechiche
- Les Garçons et Guillaume à table!, Guillaume Gallienne
- Palmarès Cannes 2013
Natacha Milkoff : lauréate du Prix Jean Lescure 2015
L’AFCAE, Association française des cinémas d’art et d’essai, organise au sein de son réseau de salles chaque année un concours de nouvelles littéraires liées au cinéma. Le prix ? Un séjour au Festival de Cannes !
Le jury composé de gens des métiers du cinéma et d’écrivains a décerné cette année leur prix à Natacha Milkoff pour sa très belle nouvelle, Jean-Louis Trintignant en quatre séquences, qui évoque la fascination qu’une femme éprouvera toute sa vie pour la voix mystérieuse de l’acteur français. Une délicate et subtile ode aux pouvoirs de séduction de la voix de Jean-Louis Trintignant que je vous encourage à lire sur le lien suivant, vous ne serez pas déçus, croyez-moi ! :
http://www.art-et-essai.org/sites/default/files/trintignant_en_quatre_sequences.pdf
Entretien avec l’heureuse festivalière.
Quelle image vous faisiez-vous de Cannes avant de venir ?
J'avais l'image classique de Cannes : paillettes et bling-bling… Mais j'écoutais aussi chaque jour les comptes-rendus et bavais d'envie de voir les films qui avaient réjoui les critiques et qui ne sortiraient pour certains pas avant l'année suivante.
Avez-vous été comblée par votre expérience ?
J’ai eu la chance d'avoir une accréditation qui m’a permis d'aller dans toutes les sélections. Cannes, c’est un paradis pour le cinéphile ! Même si le rythme est assez vite éprouvant, car on voudrait tout voir, mais on fait la queue une heure minimum avant chaque film.
Des souvenirs particulièrement forts ?
Oui ! Vincent Lindon en larmes à l'issue de la projection de La Loi du marché pendant une longue standing ovation. Pas mal de films bien sûr, dont j'espère qu'ils seront primés d'une manière ou d'une autre (La Loi du marché donc, Carol de Todd Haynes, le Nanni Moretti...). L'impression aussi d'un tout petit monde, coupé de tout le reste, centré sur un unique objet… Le sentiment que là n'est pas la vraie vie… Mais pour six jours, j'en redemande encore !
CANNES 2014 - Article 3 : winter sleep, de nuri bilge ceylan
Le temps tourne et il me faut donc ce matin conclure mes quelques réflexions sur l’édition 2014 du festival de Cannes. D’abord, tout le monde s’accorde cette année pour dire que 2014 est un bon cru. Cela nous semble juste, même si hélas nous n’avons pas pu visionner tous les films… Parmi les Palmes pressenties, en dehors de Mommy de Xavier Dolan (cf. Article 2), la Croisette parle beaucoup de Nuri Bilge Ceylan et de son Winter sleep. Quelques mots sur ce « Sommeil d’hiver » anatolien.
Le film de 3 heures 16 met en scène un homme mûr, Aydin, ancien comédien et intellectuel reconverti dans l’écriture, qui s’occupe d’un hôtel en Anatolie central dont il a hérité, ainsi que des terres et diverses propriétés. Haluk Bilginer incarne ce personnage marié à une très belle femme (Melisa Sozen), d’une vingtaine d’années plus jeune que lui : son beau visage buriné fait irrésistiblement penser à celui de James Mason, avec la même profondeur intelligente et douloureuse du regard !
Disons-le d’emblée, lui et tous les autres acteurs de Winter sleep sont exceptionnels et c’est un des grands atouts du film qui fait très vite penser à un Bergman turc, avec ses longues séquences de dialogues, s’envenimant peu à peu entre des protagonistes liés par des relations familiales tortueuses et empoisonnées par les frustrations accumulées, le ressentiment, la douleur. Le couple qui se délite était le thème des Climats (2006), un film déjà très maîtrisé formellement mais qui oppressait par sa vision suffocante des rapports hommes femme marqué par le sado-masochisme mental. Dans Winter sleep, les choses sont plus subtiles et nuancées, mais l’on retrouve cette même plainte des femmes contre des hommes oppressants par leur écrasant charisme, tout en se révélant décevants parce que finalement pas la hauteur des attentes féminines. La sœur d’Aydin est en particulier un personnage terrible de méchanceté, fruit de l’amertume et de la passivité.
La question sociale et économique est de plus un fil rouge du film, tout aussi cruel que celui des rapports psychologiques, à travers le personnage d’une famille qui ne paie pas son loyer à Aydin. Liée à cette question, celle de la montée en puissance de la religion dans l'espace social, et singulièrement celle de l’islam, est également présente à travers un personnage de jeune imam, à l’onctuosité hypocrite.
Le film, à l’atmosphère très tendue donc, serait irrespirable s’il n’ouvrait pas quelques échappées d’une beauté à couper le souffle de cette Anatolie de montagnes et de plaines, d’abord automnale puis sous la neige. La magnifique séquence où une espèce de cow-boy turc capture un cheval sauvage évoque brièvement un western anatolien, tandis que les maisons troglodytes insufflent une espèce d’étrangeté légèrement fantastique.
Le constat du film est globalement amer : une peinture mélancolique (qui fait d’ailleurs songer à Oran Pamuk) de la Turquie contemporaine et plus largement de la condition humaine. Seul le dénouement allège quelque peu le propos en ouvrant timidement une brèche vers un espoir incertain d’apaisement sentimental.
Sorti de la projection, on est un peu groggy... mais le film travaille en soi au fil des jours et sa beauté semble se déployer dans la mémoire du spectateur... Le signe d'un grand film ? La Palme 2014 ?
CANNES 2014 - Article 2: Mommy, de Xavier Dolan
Après le Saint Laurent de Bertrand Bonello, voici quelques mots sur un autre film francophone très attendu de cette sélection cannoise 2014 : Mommy.
Xavier Dolan, son réalisateur québécois, est souvent présenté depuis son premier long-métrage, J'ai tué ma mère (2009), comme un petit génie du septième art. Il faut dire qu'il est né en 1989 (faites le compte !). Sur la scène du Palais Stéphanie où il présentait son film sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, il affichait déjà alors une insolente assurance, avec sa longue mèche rebelle un peu caricaturale qu'il a depuis heureusement coupée. Depuis ce premier film très bien reçu par la critique, mais qui présentait les défauts de la prime jeunesse (notamment des effets de citations de Wong Kar Way appuyés), Dolan enchaîne les réalisations avec une régularité impressionnante: Mommy est son cinquième film ! Entre temps, il a su agacer les Festivaliers avec ses postures de sale gosse trop gâté par ses pairs et la critique: rendez vous compte, il y a deux ans, son film (Lawrence anyways) n'était que dans la sélection d'Un Certain regard, et non en sélection officielle, osait-il se morfondre à voix haute ! Mais Thierry Frémaux n'est pas rancunier: et voici le dernier opus du garçon de 25 ans en compétition pour la palme. Les bruits élogieux ne cessent d'amplifier depuis sa présentation au Palais des Festivals, à tel point que beaucoup le donnent gagnant. Quant à nous, nous avons enfin pu nous rendre compte par nous même de ses qualités cet après-midi dans la Salle du Soixantième (celle du rattrapage).
Avec Mommy, Xavier Dolan revient sur le sujet qui le hante: les relations mère-fils. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui tient le rôle du sale gosse (il a passé l'âge), mais c'est le jeune Antoine-Olivier Pilon, dont la performance impressionne. Steve est en effet un adolescent mentalement fortement perturbé, "opposant-provocateur" avec des "problèmes d'attachement" (dixit sa mère, la géniale Anne Dorval). Concrètement cela donne des éclats continuels, ponctués d'énormes insanités dont "tabernacle" (l'équivalent québécois de "putain") est le mot le plus doux, avec passages à l'acte physique qui peuvent devenir vite dangereux pour son entourage et pour lui-même. Une des forces du film est de rapidement créer une véritable angoisse chez le spectateur avec ce personnage sur la ligne de crête continuelle, et dont on craint une fois qu'il est apaisé et de bonne humeur (ce qui se traduit aussi par des attitudes borderline) qu'il ne rebascule dans la rage. Face à lui donc, Diane, la mère, se présente au début comme une femme très sexy, veuve depuis trois ans, dont l'attitude peu policée peut faire croire au début qu'elle est elle aussi fêlée. Mais non, elle est juste une espèce de mère courage qui fait comme elle peut face à cette espèce de "monstre" d'agressivité et d'affectivité mêlées qu'elle a engendré.
On ne peut s'empêcher de se demander jusqu'à quel point Xavier Dolan s'est projeté dans ce personnage de Steve et dans sa relation incestuelle avec sa mère, incarnée par la même actrice que dans J'ai tué ma mère (où il tenait donc le rôle principal). Mais là n'est évidemment pas l'essentiel, ce dernier étant comment Dolan choisit de mettre en scène cette histoire familiale explosive. Dans son précédent et très réussi Tom à la ferme, Xavier Dolan avait opté pour une nouvelle certaine sobriété (toute relative dans son cas, on part en effet de loin). Avec Mommy, Dolan revient à son hystérie assumée (le style épousant en l'occurrence le fond), à son emphase lyrique, à son baroquisme si l'on veut. Et c'est aussi comme cela que son cinéma est intense et qu'on l'aime. La direction d'acteur fait preuve d'une grande force, et si la palme de la meilleure actrice est pressentie pour Anne Dorval, il faudrait dans ce cas la donner aussi à Suzanne Clément: dans le rôle de la voisine du couple mère-fils, l'actrice (déjà présente dans J'ai tué ma mère) compose un personnage de femme blessée, qu'un événement mystérieux a rendu bègue. Son jeu tout en nuance et émotion contenue est d'une subtilité poignante, qui culmine dans sa dernière scène du film... La relation d’amitié qui s’est nouée entre ces deux femmes est d’ailleurs une des plus belles qui nous ait été donnée à voir au cinéma.
L'émotion est également forte dans les scènes de "pétage de plombs", nombreuses, que Dolan parvient à filmer avec beaucoup d'efficacité, caméra à l'épaule, visages cadrés de près. L’ultime séquence du film, qui met en scène une espèce d’affirmation de pulsion de vie et de liberté envers et contre toutes les tentatives de domptage, est enfin magnifiquement filmée.
On reste en revanche un chouia dubitative face au parti pris par Dolan de réduire son cadre à un format en deçà des quatre tiers, pour le faire varier durant le film en fonction de l'état d'esprit des protagonistes, et même le faire déployer en large seize neuvième par Steve lui-même, qui pousse les bordures du cadre un jour de grande euphorie... Non que la réduction du cadre durant la majeure partie du film ne contribue pas efficacement au sentiment d'étouffement du spectateur; mais un tel procédé de variation surlignée du format est d'une symbolique qui nous a paru un peu trop boursouflée. Cela dit, ce péché formaliste n'est pas si grave, si on le compare aux quelques séquences qui gâchent à notre avis le film et nous empêche de le désigner comme une Palme d'or désirée: je veux parler de ces séquence clipées, dignes des plus clicheteux produits filmiques hollywoodiens, où les héros exultent de bonheur, en surfant sur un skate board, en dansant dans la cuisine, ou autres activités réjouissantes, sur fond de musiques mainstream sirupeuses pour ados. Autant la séquence où les trois comédiens dansent sur une chanson kitsch de Céline Dion est émouvante et réussie car elle est intelligemment filmée, autant ces clips musicaux insérés dans le film sont une souffrance pour le spectateur, dépité par ce gâchis.
Rendez-vous demain soir pour savoir ce que le jury aura pensé de ce Mommy par ailleurs globalement enthousiasmant.
cannes 2014 - Article 1: saint laurent de bertrand bonnelo
Chers lecteurs,
Nous avons tardé cette année à vous donner des nouvelles du "plus-grand-festival-international-de-cinéma-, mais nous allons de ce pas tenter de rattraper le temps perdu. Cette année, Cannes confirme son positionnement de lieu d'accueil des cinémas des cinq continents, faisant la part très belle au cinéma d'auteur dans ce qu'il a de plus stimulant et exigeant, tout en sachant ouvrir des fenêtres au glamour et aux paillettes. Un rêve de cinéphiles, si ce n'était les heures de queue avant chaque film, mais ceci est une autre histoire, et il y aurait mauvaise grâce à se plaindre, n'est-ce pas!
Difficile encore de faire des pronostics pour le palmarès, dont la proclamation est cette année décalée, élections européennes oblige, à samedi soir. Difficile aussi encore de dégager de grandes tendances du Cannes 2014, en terme de thèmes et de styles - pour les thèmes, disons que la guerre semble une fois de plus avoir inspiré nombre de cinéastes, souhaitant témoigner, dénoncer, s'interroger... Citons par exemple The Search, Tombouctou, Les Ponts de Sarajevo ou Le sel de la terre… Quant aux styles, ils sont multiples, la diversité et l'abondance de la sélection expliquant évidemment cela. Plus modestement, voici quelques aperçus sur les films que nous avons pu déjà voir.
Commençons par un des films que nous attendions avec le plus d'excitation depuis plusieurs mois: je veux parler du Saint Laurent de Bertrand Bonello. Depuis l'annonce l'an dernier de la concurrence entre les deux "biopics", l'un autorisé (Jalil Lespert), l'autre rejeté par le "patron" Pierre Bergé (Bonello), beaucoup d'interrogations étaient nées, et notamment celle-ci : qu'est-ce qui a bien pu tellement déranger Bergé dans le scénario non autorisé? Quoi de si sulfureux, d'irrévérencieux, de scandaleux avait pu rendre le "gardien du temple" assez furieux pour empêcher Bonello et son équipe d'avoir accès à toute archive, à tout vêtement du maître?
La version avec Pierre Niney sortie cet hiver nous avait laissée sur notre faim: tout était mis en scène du point de vue du patron commercial d'YSL, le biopic n'ayant pour but que de nous montrer les développements d'une relation amoureuse houleuse, tout en étant fructueuse, sans véritablement tenter d'explorer les arcanes de la création d'un phénomène de la haute couture du XXe siècle. Le tout dans une forme soignée de film classique, luxueux et sans idée forte de mise en scène, avec la prestation de Pierre Niney que l'on redoutait: un mimétisme corporel visant la performance d'acteur, mais confinant à la singerie et faisant d'Yves Saint-Laurent un autiste quasi débile léger! Bonello ne pouvait faire que mieux, au vu de l'excellent Apollonide, avant-dernier opus du cinéaste qui avait ébloui Cannes quelques années plus tôt.
Et d'abord, saluons l'incroyable incarnation d'Yves Saint-Laurent par Gaspard Ulliel! Ce dernier n'avait encore jamais su montrer l'étendu de son talent, ayant joué dans des films très oubliables, en dehors peut-être de Mademoiselle de Montpensier (Tavernier). Il était aussi depuis quelques années un peu trop associé à une fameuse marque de parfum de luxe pour lequel Scorsese l'avait filmé dans un spot publicitaire à succès - le danger guettait de passer à côté de sa carrière et de n'être qu'un beau gosse aux yeux bleu marine. La première apparition d'Ulliel dans Saint-Laurent nous convainc et nous hypnotise d'emblée: il n'est qu'une longue silhouette lasse, filmée de dos dans un grand hôtel idéalement années soixante-dix, élégance racée, épuisée peut-être par trop de travail, trop de succès. Sa voix nous subjugue lorsqu'il demande une chambre "pour dormir". Cette voix, elle nous paraît familière, à nous qui avons entendu le véritable Saint-Laurent s'exprimer quelques fois dans les médias entre les années quatre-vingt et deux mille — un phrasé reconnaissable entre mille, à la lenteur timide, délicate et polie. Lorsque nous découvrons peu après le visage d'YSL, c'est la ressemblance qui nous frappe, une ressemblance certes fortuite entre Saint-Laurent et Ulliel, mais fruit aussi d'un travail sur la gestuelle et peut-être plus encore l'expression des yeux, de la bouche - le sourire de l'acteur étant comme l'apogée de cette ressemblance troublante, dont le génie est de ne pas tomber dans la singerie outrancière. Oui, le génie d'Ulliel est bien de préserver de bout en bout un naturel, une sobriété même, une économie d'efforts, tout ce que Niney, par ailleurs bon comédien, n'avait pas su éviter dans le film de Lespert. Saint-Laurent-Ulliel, qui est de pratiquement tous les plans, illumine de sa présence hyper charismatique tout le film de Bonello, le spectateur se sentant aimanté par le magnétisme de l’icône du XXe siècle, incarnée à la perfection par le comédien ultime, donc, dont la beauté, ne nous voilons pas la face (ô la séquence où l'acteur apparaît soudainement dans son plus simple appareil!), participe aussi de notre fascination.
Mais un acteur génial ne le serait pas autant si la mise en scène n'était pas au niveau. Disons-le d'emblée, Bertrand Bonello confirme son très grand talent dévoilé dans L'Apollonide (Le Pornographe et De la guerre faisaient déjà la preuve de son sens du cadre et du plan-séquence, mais nous avaient laissée plus dubitative quant aux propos confus développés). Saint Laurent déploie une inventivité visuelle de tous les plans, composant des séquences somptueuses, à l'image de son sujet YSL, créateur d'une nouvelle silhouette ayant bouleversé les codes du féminin. Le bonheur esthétique du spectateur est infiniment renouvelé, tandis que les mystères de la psyché de cet homme singulier sont sondés, sans jamais de lourdeurs psychologisantes. Ainsi de la séance de photographie où YSL décide inopinément de poser entièrement nu (on se souvient tous de ce magnifique cliché en noir et blanc de Jean-Loup Sieff); ou de sa rencontre en boîte de nuit avec Jacques de Bascher (Louis Garrel, pas vraiment à son meilleur dans ce rôle). On pourrait aussi évoquer cette séquence presque fantastique où une mannequin habillée d'un costume masculin pose de manière incongrue dans une rue, la nuit, aux côtés d'une autre mannequin elle entièrement nue.
Ces exemples pourraient faire penser aux lecteurs que la nudité est un thème omniprésent dans ce film, mais tel n’est pas le cas, et d'ailleurs, on cherche en vain le "trash" qu'on supputait avoir outré Bergé. Bonello fait preuve d'une nouvelle sobriété dans Saint Laurent, d'une pudeur même, évitant de s'appesantir sur les moments d'orgie ou d'amours tarifés dans les ruelles parisiennes. Pierre Bergé (impeccable Jérémie Régnier) s'en sort d'ailleurs bien dans le film, tout au plus apparaît-il comme un capitaine d'industrie ambitieux et rigoureux, ce dont on se doutait déjà. La mégalomanie du patron de la firme serait-elle telle qu'il n'aurait accepté qu'un film construit autour de sa personne ? Le point de vue du film de Bonello, en tout état de cause, c'est le sien, celui du cinéaste qui scrute l'univers mental de son héros et prend plaisir à restituer une époque (les années 60 et 70), dont le recul temporel ne fait que magnifier la beauté du "style".
Il y aurait encore beaucoup à dire sur Saint Laurent, comme le choix troublant d'Helmut Berger (icône viscontienne) pour incarner YSL vers la fin de sa vie, ou la beauté insolente et énergique d'une nouvelle venue, Aymeline Valade (Betty Catroux); ou encore l'utilisation un peu trop décorative en revanche de Léa Seydoux en Loulou de la Falaise (quasi muette !). Mais l'on finira seulement par émettre un bémol après tous nos éloges : le film dure 2h30, une durée qui ne nous semble pas bien justifié; pire, la dernière heure de Saint Laurent nous a donné l'impression d'étirer inutilement le propos, au risque, hélas, de confiner tout à coup au maniérisme, voire au fétichisme agaçant. Certains se sont extasiés du défilé de mode filmé en split screen, à la manière d'une composition de Mondrian. Pour nous, parvenue à près de deux heures de film, cette séquence a paru presque trop attendue, comme un clin d'oeil au tic esthétique des années soixante-dix (remember Thomas Crown) et finalement un peu facile.
Cannes 2014 terminé, nous aurons à cœur de retourner cet automne voir le film en salle pour mesurer si notre lassitude était due à la fatigue cannoise ou bel et bien à un péché de metteur en scène - comme si longueur du film équivalait à profondeur et œuvre "palmable".
La Vie d’Adèle, Abdelattif Kechiche
Festival de Cannes 2013
Une palme d'or et de feu
Le dernier vendredi de cette édition cannoise 2013, la queue était dense devant la « Salle du Soixantième » pour voir le film en sélection de Kechiche. C’est que le bouche-à-oreille était excellent, le film ayant été projeté la veille dans l’immense salle Lumière. Une de mes amies, qui n’est hélas pas pourvue du badge sésame « Presse », reste en rade dans sa ligne à elle, tandis qu’après une heure et demi de patience, j’entre enfin dans le saint des saints pour découvrir ce film monté dans l’urgence pour être à temps sur la Croisette — si bien que le générique en est encore absent.
Les premiers plans du film ne laissent pas de doutes : on est bien dans l’univers de Kechiche. L’actrice qui incarne le rôle-titre est de quasiment tous les plans, la caméra s’attachant à son visage, ses gestes, sa démarche, dans une quête attentive et passionnée de l’être humain, dans ses trivialités comme dans ses fulgurances. Cette « vie d’Adèle » fait d’emblée référence à Marianne, le personnage de Marivaux du roman picaresque (la Vie de Marianne), manifestement un auteur cher à Kechiche si l’on en croit déjà L’Esquive. Le réalisateur prend au sérieux la façon dont les écrivains découverts à l’aube de la vie d’adulte nourrissent l’imaginaire, donnent à penser, influent sur les impulsions et les choix. Les professeurs sont dépeints par Kechiche avec un respect empathique pour le travail de passeur et d’accoucheur qu’ils peuvent avoir lorsqu’ils s’attachent à leur métier. C’est le cas des enseignants de la lycéenne Adèle. Et l’on peut penser que sa propre vocation de professeur des écoles (« institutrice » est le mot utilisé dans le film) n’est pas étrangère au plaisir qu’elle a éprouvé en classe de français. C’est au cours d’une de ces lectures à l’oral de La Vie de Marianne que le sujet du film est lancé : « «Je m’en allais avec un cœur à qui il manquait quelque chose, et qui ne savait pas ce que c’était…» Les lycéens sont interrogés sur le sens de ce « manque au cœur ». Prélude aux tâtonnements amoureux d’Adèle avec un garçon de son âge, avant de croiser dans la rue, comme dans un rêve, la fille aux cheveux bleus qui lui laissera un manque au cœur, sans qu’elle ne sache encore ce que c’est…
La Vie d’Adèle s’attache à ce moment si particulier qu’est le passage de l’adolescence à l’âge adulte, cette tranche de vie entre 16 ans et disons 23 ans, où tout est nouveau, infiniment intense, dangereux, crucial, comme irréversible. Ce moment où se vivent les premières vraies histoires d’amour, la découverte de la sexualité. Et où se décident les choix professionnels qui engageront souvent toute une vie. Si le film de Kechiche a su remuer tant de spectateurs cannois conquis, c’est évidemment pour la force de sa mise en scène, la radicalité naturaliste de sa direction d’acteurs, l’audace inédite dans le cinéma d’auteur des scènes charnelles entre deux femmes, mais aussi certainement pour le sujet universel qu’il traite : pas seulement la naissance puis la décadence de la passion amoureuse et charnelle, mais aussi, il me semble, ce moment transitoire et absolument bouleversant de notre existence au sortir de l’adolescence.
Kechiche, il l’a redit au moment de recevoir sa palme d’or, a voulu mettre en scène l’amour entre deux êtres au-delà de la question de l’orientation sexuelle. Et c’est comme cela que l’ont reçu aussi les membres du jury présidé par Spielberg, qui, soit dit en passant, a montré pas mal de hardiesse à primer ce film qui risque de ne pas sortir aux Etats-Unis dans des réseaux de salles lambda. Disons que la force de La Vie d’Adèle c’est de ne pas occulter la question de l’hétérosexualité vs l’homosexualité, avec les interrogations du Sujet sur ses orientations personnelles, les réactions diverses de son entourage (amis, parents…), les combats à mener pour l’égalité des droits… Tout en réussissant à banaliser l’homosexualité en dépassant ce « particularisme » pour traiter de la passion amoureuse dans son absolu humain. La palme conjointe attribuée aux deux actrices du film apparaît ici parfaitement justifiée : Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux (alias Emma) livrent une interprétation ébouriffante de justesse, de vérité, à tel point que l’on croit assister à un pur documentaire. La méthode de direction d’acteurs de Kechiche avait certes déjà prouvé son efficacité depuis son génial premier film, La Faute à Voltaire. On s’interroge sur la rudesse du tournage pour les actrices (laissons de côté les polémiques actuelles qui déchaînent les gazettes), qui ont payé de leur personne à un point qui, avouons-le, nous a à la fois subjugué et embarrassé. Les scènes de sexe sont d’une frontalité si criante de vérité, les longs plans-séquences laissant peu de possibilité à la simulation, que l’on hésite entre l’admiration médusée pour la captation de ce mystère du plaisir charnel, et la gêne d’entrer par effraction dans la chambre à coucher de voisines. A fortiori par l’entremise de l’œil d’un réalisateur, d’un homme mûr de surcroît. Eternelle question du cinéma comme dispositif voyeuriste/fétichiste phallocentré (cf. Laura Mulvey)… La dignité donnée au plaisir dans sa beauté nue et le respect empathique pour ses personnages tout au long du film font toutefois pencher le spectateur (la spectatrice ?) en faveur de Kechiche, qu’on a du mal à considérer comme un agent avilissant du patriarcat archaïque ! Dommage cependant qu’une vieille lune soit proférée vers le dernier tiers du film par un personnage de galeriste sympathique et qui pourrait passer comme un porte-parole du réalisateur : le plaisir féminin serait plus mystique que le plaisir masculin, plus cosmique, etc. Ah bon ?
Le film de Kechiche fait près de trois heures, ce qui lui permet d’étudier, après la naissance et le déploiement d’une passion amoureuse, son érosion, son dénouement funeste, puis son épilogue après la séparation et les trajets de vie disjoints. Et c’est là l’autre sujet central de La Vie d’Adèle qui ne manque pas de force : si les deux jeunes femmes finissent par s’éloigner, c’est que le sentiment amoureux et la passion physique ne suffisent pas à dépasser les antagonismes sociaux. Le film montre en effet comment l’origine sociale des êtres les emprisonne dans l’imaginaire de leur classe. L’artiste, la fille aux cheveux bleus, a des parents qu’on imagine post-soixantuitards, hyper ouverts, cultivés, qui mangent des fruits de mer lorsqu’ils invitent la copine de leur fille, et offrent un vin blanc sélectionné avec la connaissance du gastronome. L’institutrice, fille de prolétaires, ne peut avouer à ses parents son homosexualité, et mange goulûment à table les spaghettis bolognaises que les parents cuisinent le jour où Emma est invitée. Une des observations très justes du film est le léger mépris qu’Emma et ses amis artistes et thésards éprouvent pour le métier d’institutrice d’Adèle. Il faudrait qu’Adèle devienne l’écrivaine qu’elle est en puissance, qu’elle s’exprime, bref, qu’elle réussisse sa vie, ce qui ne semble pas concevable si elle se cantonne à exercer son métier d’instit bien sympathique, mais… Kechiche épingle ce préjugé social, en donnant à voir la dignité, l’importance et la difficulté du métier d’enseignant pour les plus petits à l’orée de la vie.
Le film de Kechiche était donné par beaucoup gagnant dimanche avant la proclamation du palmarès, mais des hésitations légitimes se faisaient entendre : Spielberg et son jury vont-ils oser ? Nous avons nous-même soupesé les personnalités supposées des membres du jury, en évaluant les chances que le réalisateur de Brokeback mountain (Ang Lee), que celui de Au-delà des collines (Cristian Miungiu), que les réalisatrices Lynn Ramsay et Naomie Kawase donneraient leurs suffrages, tout comme le feraient Daniel Auteuil et Christoph Walz. Et Nicole Kidman, sera-t-elle trop prude ? Mais elle a joué jadis dans Dogville, tout de même ! Et dans Eyes wide shut ! On aimerait bien être une petite souris pour assister aux débats de ces jurys cannois… En tous cas, en couronnant La Vie d’Adèle, Cannes a su s’affirmer comme un festival fidèle à une réputation qu’on espère perdurer : politique dans le meilleur sens du terme, artistique, audacieux.
Les Garçons et Guillaume à table!, avec et réalisé par Guillaume Gallienne
Festival de Cannes mai 2013 (Prix Art Cinema Award, Quinzaine des réalisateurs)
Certains l’aiment chaud…
Guillaume Gallienne est un garçon à la mode depuis quelques temps maintenant: on peut l’entendre sur France Inter lire des textes choisis (« Ca ne peut pas faire de mal »), le voir sur Canal plus dans des bonus comiques où son goût pour le travestissement s’assouvit à plein. Sur grand écran, l’acteur s’illustre toujours avec bonheur dans un certain nombre de seconds rôles comiques ou dramatiques (sa prestation d’homme d’église dans Confessions d’un enfant du siècle permettait de découvrir son impeccable accent anglais). Et enfin, les plus chanceux ont pu voir le sociétaire de la Comédie française sur les planches, ou l’admirer dans sa pièce de théâtre à succès : Les Garçons et Guillaume à table ! Ce dernier spectacle, dont il est aussi l’auteur, s’inscrit dans une veine autobiographique un peu particulière et que d’aucuns ont nommé : le « coming out hétérosexuel » ! C’est ce spectacle que Gallienne a entrepris d’adapter lui-même pour le cinéma : pari risqué, car tomber dans l’écueil du théâtre filmé eut été facile. Mais Guillaume Gallienne avoue être un cinéphile averti, et son passage à la réalisation se révèle parfaitement maîtrisé. Dans la salle du Palais Stéphanie où le film était projeté (Quinzaine des réalisateurs), une standing ovation de près de quinze minutes à l’issue du film atteste que mon avis est largement partagé.
Enfin, disons-le d’emblée, les toutes premières minutes nous ont fait craindre le ratage : on y voit en effet Gallienne se préparer dans sa loge de théâtre, quelques instants avant son entrée en scène, se regardant avec gravité dans le miroir, en pleine concentration anxieuse. Ce début un peu convenu est surtout rendu assez insupportable par une musique sirupeuse, semblant dire aux spectateurs : « Attention, émotion ! ». On n’a pu d’ailleurs s’empêcher de songer à un film récent très réussi, Le Temps de l’aventure, dans un registre différent, qui commençait aussi par une pré-entrée en scène de l’héroïne, dans ce moment si tendu pour le comédien, sorte de saut dans le vide périlleux et grisant. Dans ce film, ce prologue fonctionnait à merveille, notamment car il n’était pas lesté d’une bande sonore lourdingue. Bref.
Ce moment de doute sur Les Garçons et Guillaume à table ! fut heureusement vite balayé par la suite qui nous fit découvrir le dispositif choisi par Gallienne : l’ancrage initial sur les planches, le comédien faisant face à un public hors champ (miroir de nous-mêmes spectateurs), et le passage insensible et fluide à l’illusion réaliste du cinéma. Un dispositif payant qu’utilisait jadis Autant-Lara dans son adaptation géniale d’Occupe-toi d’Amélie ! Et d’emblée, on découvre une des grandes trouvailles du film de Gallienne : s’autoriser à incarner à la fois le personnage de Guillaume (lui-même, donc) adolescent, sans transformation physique particulière, en dehors de sa puissance de jeu pour retrouver les accents d’un garçon de douze ans, et le personnage de sa mère, perruque blonde, lunettes et vêtements ad hoc ! Les deux personnages apparaissant dans les mêmes plans, se donnant le réplique, dans une folle logique imparable du scénario : puisque l’adolescent Guillaume admire sa mère au point de céder au mimétisme et de troubler son entourage (sa grand-mère, son père) qui prennent Guillaume, lorsqu’ils ont le dos tourné et ne font que l’entendre, pour la mère de celui-ci ! Il y a une grande jubilation à contempler Guillaume Gallienne jouer cette femme, grande bourgeoise hyper sûre d’elle et quelque peu excentrique, que le garçon, puis le jeune homme, ont contemplé passionnément comme l’incarnation ultime de la féminité, d’une féminité fascinante, comme l’explique Guillaume-ado : « Elle est géniale, ma mère ! Elle est encore plus belle quand elle parle espagnol. » C’est d’ailleurs d’abord en Espagne que le film nous mène, Guillaume ayant découvert au cours d’un voyage linguistique à quel point tout le monde le prenait pour une fille quand il dansait la sévillane — ce qui commence par le perturber un peu, puis ce qu’il accepte comme un compliment.
Le film nous raconte donc comment ce rejeton d’une fratrie de trois garçons, issu de la grande bourgeoisie très aisée, est désigné implicitement par sa mère comme un être à l’identité genrée à part. Le titre de la comédie n’étant que la citation de la phrase rituelle prononcée par la mère pour appeler ses enfants à dîner. Le jour où, jeune adulte, Guillaume s’invite à une « soirée de filles » organisée par une amie, et qu’il entend cette dernière appeler les convives par un « Les filles et Guillaume à table ! », le déclic se produira, celui-ci permettant au jeune homme de s’autoriser à tomber amoureux d’une femme. Avant cette issue que Guillaume Gallienne présente comme une délivrance, le jeune homme aura à subir les vexations de ses frères, les bizutages de ces copains machos, le regard sévère de son propre père, mais il aura aussi à vivre des tâtonnements sentimentaux et sexuels cruels. Cette histoire d’un itinéraire de vie compliqué par une identité genrée perturbée, Gallienne a choisi de la mettre en scène avec truculence et autodérision. Et ce parti pris donne lieu à des scènes hilarantes, dont on parie qu’elles seront bientôt d’anthologie, à l’instar de ces soirées dans les dortoirs d’une pension où les homologues de l’adolescent expérimentent leur sexualité masculine comme s’ils étaient enfermés dans une prison turque (dixit Guillaume). Ou de cette séquence ahurissante de drôlerie où l’adolescent s’imagine à la fois sous les traits de Sissi impératrice et de sa belle-mère l’archiduchesse ; ou bien encore de ces séquences en cure médicale en Allemagne où Gallienne se retrouve tour à tour entre les mains d’un Teuton géant peu délicat puis d’une Gretchen interprétée avec délice par Diane Kruger en roue libre! La force de Les Garçons et Guillaume à table !, c’est de réussir ces séquences loufoques, tout en évitant le film à sketchs, et en maintenant une profondeur psychologique et une délicatesse de touche jamais démentie. Gallienne est émouvant derrière son autodérision et sa moquerie pour sa mère qu’il réussit à ne pas éreinter, la tendresse affleurant toujours in fine. On pense un peu à Woody Allen, forcément, a fortiori pendant les séquences chez les psy, compatissants. Mais l’analogie s’arrête là, car Guillaume Gallienne a une personnalité totalement singulière.
Le film enfin résonne particulièrement en ces temps de débats sur le « Mariage pour tous », où les contempteurs de la nouvelle loi ne désarment toujours pas. Si le comédien-réalisateur s’est (re)trouvé en assumant son hétérosexualité, il ne faudrait surtout voir dans son propos une stigmatisation de l’homosexualité ! Gallienne semble d’ailleurs assumer aussi parfaitement sa part féminine, continuant à se travestir avec bonheur dans ses rôles (voir les Bonus de Canal plus). On ne vous dévoilera pas la réplique finale de la mère de Guillaume, lorsque celui-ci lui apprend qu’il va se marier avec « Amandine ». Digne de Certains l’aiment chaud !, dont on devine que le comédien doit l’avoir parmi ses films de chevet.
Cannes 2013 : une Palme hexagonale et trois actrices françaises couronnées!
Comme tous les ans, le Festival de Cannes permet de se faire une bonne idée de l’état mondial de la production du septième art. Cette année, Cannes avait enfin réussi à attraper Steven Spielberg entre deux tournages pour présider un jury éclectique, avec des personnalités fortes comme le réalisateur Cristian Miungiu ou l’acteur Christoph Walz — un jury qui a su couronner avec raison un film fort et audacieux : La Vie d’Adèle.
Tout le monde a remarqué que la sélection cannoise 2013 faisait la part belle aux Français et aux Américains. Mais lorsqu’on étudie le palmarès final, on constate aussi le retour en force du cinéma asiatique. Le Prix du jury pour le Japonais Koré-eda (Tel père, tel fils) ne surprend pas tout à fait : non seulement le film est très beau et délicat, mais le questionnement sur les tenants et les aboutissants de la paternité ne pouvait que séduire Spielberg. Le prix pour le scénario récompense lui le Chinois Jia Zankhe (A touch of sin), immense cinéaste qui continue, avec cet état des lieux de la Chine contemporaine, à interroger la violence sociale et économique qui fauche les habitants de son pays. Avec en outre la Caméra d’or pour un premier film singapourien (Ilo ilo) et la Palme du court-métrage pour un jeune Coréen (Safe), Cannes souligne donc bien la vitalité du cinéma extrême-oriental.
Cinéma américain…
Les Américains ne sont toutefois pas totalement en reste. Si le Prix du meilleur acteur revient à Bruce Dern (76 ans !) pour son rôle dans Nebraska (A. Payne), l’Américano-mexicain Amat Escalante remporte le Prix de la mise en scène pour Heli, un film ancré dans la réalité terrible d’une région déshéritée du Mexique, entre dealers de drogue et adolescentes filles-mères. Quant aux frères Coen, grands habitués de Cannes, ils remportent un nouveau prix avec leur Inside Llewin Davis (Grand Prix), odyssée d’un magnifique looser, chanteur de folk dans le Greenwich village des années 60. Si les deux frères démontrent une fois de plus leur génie pour croquer des personnages en deux plans et pour faire naître l’insolite au coin de la rue, il nous a semblé toutefois que leur nouvel opus recyclait un peu trop leur éternelle obsession de l’anti-héros qui a la guigne.
Cinéma français…
Et la France, dans tout cela ? Avec cinq films en compétition officielle, le cinéma français peut s’enorgueillir de tenir son rang dans le concert international. Bérénice Bejo — dans le film produit par la France et se déroulant dans l’hexagone — de l’Iranien Asghar Farhadi, prouve à ceux qui en doutaient encore qu’elle est une très grande comédienne, et pas seulement muette ! Le Jury cannois l’a très justement reconnue. Deux autres prix d’interprétation féminine à des Françaises ont été décernés cette année par le Jury enthousiasmé par La Vie d’Adèle. Et ce n’est que justice : Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos y livrent une performance époustouflante. Le film d’Abdelallatif Kechiche qui reçu la récompense suprême retrace l’itinéraire d’une lycéenne de Lille, Adèle, dans son passage à l’âge adulte. Le réalisateur, d’origine tunisienne et qui a passé son enfance à Nice, explore l’émergence d’une identité — sexuelle, sociale, professionnelle — dans un film de trois heures qui prend le temps de scruter la vie, la passion, dans tous leurs méandres. Le film impressionne par sa mise en scène toujours au plus près de ses actrices, comme Kechiche le faisait déjà dans La Faute à Voltaire ou La Graine et le mulet. Il nous parle de la façon dont les êtres, enfermés dans leur origine sociale, ont du mal à sortir de l’imaginaire de leur classe. Il aborde aussi avec franchise l’homosexualité féminine, dans des scènes charnelles comme on n’en a peut-être jamais vu au cinéma, avec des plans-séquences frontaux, où les actrices livrent leur désir et leur plaisir avec une rage passionnée, sans pudeur.
(Homo)sexualité et violence
Ces thèmes de la recherche d’une identité sexuelle, de la passion charnelle, et singulièrement de l’homosexualité, auront d’ailleurs été récurrents dans ce Festival de Cannes. Le Jury d’Un Certain regard a ainsi décerné le prix mérité de la mise en scène au film d’Alain Guiraudie, L’inconnu du lac, une histoire de rencontres homosexuelles autour d’un lac du sud de la France, avec des séquences de sexe non simulées qui ont fait quelque peu le buzz sur la Croisette. Le film de Cronenberg sur Liberace, chanteur gay interprété par un Michael Douglas ébouriffant, ou la géniale comédie en compétition à la Quinzaine des réalisateurs de Guillaume Gallienne, Les Garçons et Guillaume, à table!, auront achevé de convaincre que le cinéma se fait bien le sismographe des questionnements contemporains de la société (on pense bien sûr aux récents débats autour du « mariage pour tous »). Enfin, si la violence du monde réel imprègne nécessairement les films, on sait gré au Jury cannois de ne pas avoir décerné de prix au très formaliste Only god forgives, dans lequel on ne croit déceler de la part de Nicolas Winding Refn que pur plaisir sadique vain dans ses séquences à la violence insoutenable.
(Paru dans La Gazette de Monaco - juin 2013. Droits réservés)