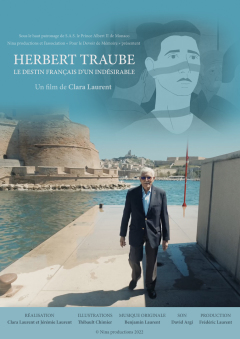Greta Garbo, Jeanne Moreau, Sylvia Kristel et le mythe de la danseuse-espionne
Le monde de l’espionnage est le règne du pouvoir de l’ombre. Dans cet univers de faux-semblant, de duperie, de manipulation, les femmes ont été rapidement identifiées comme de potentiels agents de renseignements efficaces, détenteurs d’un pouvoir spécifique : leurs corps. Comme l’a montré Michelle Coquillat[1], le pouvoir féminin, pouvoir de la sexualité, a nécessairement partie liée avec le pouvoir occulte, ne pouvant exister qu’en marge du pouvoir symbolique et officiel,détenu par les seuls hommes. Tout se passe donc comme si la femme était vouée par excellence à ce métier obscur que constitue l’espionnage. Parmi les espionnes célèbres de l’Histoire, il en est une qui se distingue entre toutes, ne serait-ce que parce que son nom est devenue ce que la stylistique nomme une antonomase — un nom propre qui se substitue à un nom commun. Cette espionne, c’est Mata Hari.
Mata Hari inspira l’écran dès l’époque du muet, avec Mata Hari, the red dancer (1919), Mata Hari (Ludwig Wolff, avec Asta Nielsen, 1920), ou encore Die rote tanzerin (Friedrich Feher, avec Magda Sonja, 1927). Dans Marthe Richard au service de la France, film français de 1937, Mata Hari apparaît comme personnage secondaire sous les traits d’une actrice française peu connue (Délia Col). D’autres films parlants ont centré leur intrigue sur l’espionne légendaire: trois films réalisés à des époques éloignées dans le temps, preuve de l’intérêt renouvelé pour le mythe. Il s’agit du film américain de 1931 avec Greta Garbo, réalisé par George Fitzmaurice (Mata Hari), du film français de 1964, Mata Hari, agent H21, réalisé par Jean-Louis Richard avec Jeanne Moreau, et enfin du film américain de 1984, Mata Hari, réalisé par Curtis Harrington avec Sylvia Kristel. Ce sont ces trois films que nous examinerons ici. Notons que la MGM a lancé le film de Fitzmaurice avec Greta Garbo en riposte à Agent X27 de Sternberg, produit par la Paramount, avec la rivale allemande de la Suédoise : Marlene Dietrich. Ceci peut expliquer la raison pour laquelle le film de la Paramount est souvent assimilé à un film sur Mata Hari, bien que le personnage d’Autrichienne incarné par Dietrich soit sensiblement différent de l’espionne-danseuse hollandaise.
Des années trente aux années quatre-vingt, en passant par les années soixante, comment a évolué la vision de la célèbre espionne ? Chaque film peut être considéré comme un « film véhicule » pour chacune des stars qui incarnent la figure mythique : Greta Garbo, Jeanne Moreau, Sylvia Kristel. Comment s’articule la persona de ces différentes actrices avec la femme au pouvoir occulte, espionne mythique, objet de controverse historique : Mata Hari ?
Mata Hari : redoutable espionne ou victime des hommes ?
Margueritte Zelle, alias Mata Hari, née en Hollande en 1876 et fusillée pour haute trahison à Vincennes en 1917, est devenue très rapidement le parangon de l’espionne. Elle représente la synthèse parfaite de tout ce que l’imaginaire collectif projette sur cette figure — d’où la fortune immédiate et pérenne du mythe. Femme mystérieuse, à l’identité trouble, on la dit fille d’une Javanaise qui lui aurait transmis la connaissance de rites sacrés, à moins qu’elle ne soit qu’hollandaise, ou cosmopolite, sans vraie patrie... Femme fascinatrice, belle ensorceleuse au corps souple de danseuse, mais cachant une âme d’intrigante, de manipulatrice. Femme vénale, enfin, monnayant ses charmes contre de l’argent et/ou des renseignements.
Tous ces éléments sont contenus dans l’expression populaire : c’est une vraie Mata Hari ! Il n’est pas sûr en revanche que la majorité ait à l’esprit une autre facette-clef de la figure de Mata Hari : l’espionne tomba amoureuse. Cette passion pour un officier russe au service des Français fut aussi sa perte. Car si toute femme devrait intrinsèquement avoir les atouts que nous avons évoqués pour faire une bonne espionne, elles ont cependant un talon d’achille : elles sont sentimentales. Or, un espion se doit d’être un animal à sang froid. Il n’a pas le droit d’être émotif, et ne doit se laisser troubler par aucun sentiment humain inutile. Un espion amoureux n’est plus bon à rien.
Les films qui abordent l’histoire de Mata Hari sont toujours construits autour de cette problématique. Ils prennent position pour jauger, d’une part, le degré de cynisme, de vénalité et d’efficacité de la fameuse espionne, et d’autre part, le degré d’émotivité, c’est-à-dire d’humanité de l’espionne finalement exécutée par la France. Plus le personnage de Mata Hari est passionné, émotif, sentimental — plus il est en somme maladroitement « humain » — et moins il est sujet du savoir et du pouvoir. Et inversement.
Si les trois films que nous allons analyser envisagent cette problématique habituellement liée à tout personnage d’espionne, ces films prennent aussi position dans un débat spécifique concernant la réelle Marguerite Zelle. Celle-ci est en effet l’objet de polémiques débattues depuis des décennies par les historiens. Mata Hari était-elle une espionne efficace au service de Guillaume II ? Ou bien un agent médiocre, mais providentiel bouc émissaire d’une Armée française en mauvaise posture en 1917 ?
Femme-objet, femme-sujet : regard, savoir, pouvoir.
Ni le film de Fitzmaurice, ni ceux de Richard et d’Harrington ne montrent l’édification par Mata Hari elle-même de son personnage de légende. Ils débutent leurs récits alors que la jeune femme est déjà la célèbre danseuse portant des tenues orientales ultra-dénudées, faisant d’elle une femme fétiche. L’espionne fait sa première apparition à l’écran en s’exhibant au regard des spectateurs dans ses danses mystérieuses. Garbo et Moreau dansent sur une scène devant un public, tandis que Kristel danse dans la jungle javanaise, les seins nus, en s’offrant au regard de la caméra. Ainsi le personnage est d’emblée posé comme figure érotique, objet du désir, objet du regard de la caméra et — c’est le cas pour Garbo et Moreau — de spectateurs charmés, voire hypnotisés.
Dans les cas de Moreau et de Kristel, le film tout entier perpétue cette position habituelle du cinéma narratif classique qu’a analysée Laura Mulvey dans son texte fondateur de la théorie féministe du cinéma[2]: femmes exhibées, objets inlassables du regard de la caméra et des spectateurs. Jean-Louis Richard (époux à la ville de Jeanne Moreau) et François Truffaut, coscénariste à cette occasion, ont de leur propre aveu conçu Agent H21 comme une sorte de documentaire sur la femme Jeanne Moreau, sur son visage, ses gestes, ses habitudes. Quant à Sylvia Kristel, star du cinéma érotique des années 70, elle ne parvînt pas à s’émanciper du premier rôle-phare qui la lança de manière fulgurante. Pour le public, l’actrice hollandaise et le personnage sulfureux d’Emmanuelle ne font qu’un, comme s’en plaint l’actrice dans son autobiographie [3]. Tout se passe donc comme si les auteurs du film avaient voulu refaire Emmanuelle, « version Mata Hari ». En témoignent notamment les scènes érotiques obligées, en échos à Emmanuelle, qui émaillent le film : scène lesbienne, exhibition devant plusieurs, masturbation, coït en amazone….
Si Mata Hari-Moreau et Mata Hari-Kristel peuvent être, du point de vue du récit, sujets de leur désir lorsqu’elles choisissent librement leurs amants, elles restent néanmoins essentiellement objets du désir de la caméra et très peu sujets du savoir et du pouvoir.
Sylvia Kristel, en effet, paraît ne pas du tout maîtriser sa destinée. Le film la montre en effet contrainte d’entrer dans l’espionnage : elle fait l’objet d’un odieux chantage de la part des services secrets allemands. L’actrice paraît ensuite sans cesse ballottée par les événements et les divers manipulateurs qui en veulent finalement surtout à son corps si beau.
Jeanne Moreau, quant à elle, est mise en scène d’abord comme une jeune femme légère, séductrice, accomplissant des actes d’espionnage pour s’offrir le luxe dont elle raffole. Mais très vite lassée par ces besognes usantes, elle veut rompre avec les services secrets, qui la contraignent par chantage à rester à leur service. Par-dessus tout, l’espionne apparaît fort maladroite : elle ne sait pas tirer au revolver, fait tomber du révélateur sur l’encre sympathique d’un message (ce qui la compromet), ou bien encore oublie sa propre photo sur le coffre qu’elle vient de dérober ! Heureusement, un fidèle chauffeur veille sur l’espionne tête en l’air et répare ses diverses gaffes. C’est un ange gardien appointé, à l’insu de la belle, par les services secrets. Le film suggère en fait que si Mata Hari exerce le métier lucratif d’agent secret, c’est pour entretenir un père oisif, marginal bonhomme qui vient sans cesse lui réclamer quelques sous. Elle finit même par évoquer à son père adoré son envie de fuir le métier et de partir en Hollande avec lui: « Je n’ai jamais aimé personne d’autre », lui dit-elle! La sulfureuse Mata Hari n’est donc qu’une bonne fille, au complexe d’Œdipe mal résolu… Enfin, Jeanne Moreau paraît tout au long du film de plus en plus épuisée, sujette à des crises nerveuses, et fuyant telle une biche aux abois. Au fond, la belle espionne est surtout tellement humaine, semble plaider le film. Le réalisateur est amoureux de son actrice au point de ne quasiment jamais la quitter du regard, Jeanne Moreau étant de tous les plans : « Tu es belle, mais tu es aussi fragile, alors j’aime bien te regarder de très près, c’est très émouvant », lui déclare son amoureux, Jean-Louis Trintignant, évident porte-parole du réalisateur.
Lors de sa première apparition dans le film de Fitzmaurice, Garbo elle aussi est dans la position d’objet du regard, mais d’une manière sensiblement différente. Certes, elle est bien admirée par un public séduit. Mais Garbo semble pourtant ne pas s’offrir aux spectateurs. Elle s’adresse en effet à la grande statue de Shiva qui trône sur la scène et lui lance amoureusement : « C’est pour toi que je danse ce soir, comme je dansais dans le temple sacré de Java ». Le film la cadre alors en pleine conversation intime, comme si Garbo n’avait cure de la présence des spectateurs. La séquence alterne des plans sur le public, avec des plans plus serrés sur Garbo en communion avec la statue, et le point de vue le plus fréquent est pris derrière la statue, embrassant soit la danseuse et la statue, soit englobant ces deux dernières et les spectateurs attentifs. Le public devient presque autant objet du regard de la caméra que l’est la danseuse.
La suite du film de Fitzmaurice met en scène une femme souveraine, fière et ironique avec les hommes qu’elle toise avec insolence de sa grande taille élancée. L’actrice porte souvent, sous ses jupes largement fendues, des collants-pantalons mettant en valeur de longues jambes, qu’elle croise virilement, assise nonchalamment devant un patron auquel elle n’hésite pas à désobéir effrontément. En prison, son sobre bandeau noir autour des cheveux accentue son androgynie.
Dès le début du film, la lucidité de Mata Hari-Garbo quant à son statut d’employée corvéable apparaît d’emblée évidente. S’y révèle aussi le peu de cas que l’espionne fait des hommages masculins. Garbo n’est dupe de rien. Elle sait ce qu’elle veut. Elle sait aussi ce qu’elle vaut. Lors d’une scène où elle se trouve sérieusement menacée pour avoir désobéi, la jeune femme affirme haut et fort, d’un geste majestueux: « Je suis Mata Hari. Je suis mon propre maître ». Contrairement à Jeanne Moreau et Sylvia Kristel, la Mata Hari incarnée par Garbo n’est pas mise en scène comme une jeune femme passive, irresponsable de ses actes. Bien au contraire, elle peut même se montrer narcissiquement perfide. Ainsi, tandis qu’elle passe une nuit avec son jeune capitaine russe afin de lui dérober des renseignements, elle exige de lui une preuve d’amour qui coûte infiniment au jeune homme. Il doit rompre un serment fait à sa mère en éteignant la bougie qui trône devant une icône représentant la Vierge. Le jeune Russe, bouleversé, cède. L’espionne triomphe de la Madone avec un plaisir non dissimulé. Cette séquence témoigne du cynisme de Mata Hari et montre sa volonté de puissance. De même, lors d’un souper fin avec un agent russe plus âgé et follement épris d’elle, Garbo n’hésite pas à exercer habilement un chantage affectif et sexuel pour obtenir les renseignements qu’elle convoite. Mata Hari-Garbo est donc bien une espionne compétente, qui saura plus loin abattre à bout portant le même agent lorsqu’elle le jugera nécessaire.
La chute de Mata Hari : le pouvoir et la mort.
Alors que le film de 1931 brosse donc le tableau d’une espionne compétente, affirmant une certaine appétence pour le pouvoir, en revanche, le film de 1964 dessine le portrait d’une piètre espionne et celui de 1984 met en scène une espionne malgré elle. Tout se passe comme si ces deux derniers films s’employaient à déconstruire le mythe de Mata Hari redoutable calculatrice vénale, pour la déresponsabiliser et « l’humaniser ». Ne reste, dans ces deux films de 1964 et 1984, que le caractère sensuel de l’espionne ; ne lui est concédé que le pouvoir de la chair qu’elle exerce sur ses proies. Mais là encore, le discours est ambivalent.
Mata Hari-Moreau est sexuellement libre: elle prend des amants dans le cadre de son travail d’espionne, mais aussi pour le plaisir. Toutefois, tout se passe comme si ces mœurs émancipées étaient finalement sanctionnées. Lors de son exécution par les soldats au petit matin, l’actrice est montrée comme une fragile silhouette qui s’effondre contre le peloton ; puis, s’incruste en surimpression l’image de la jeune femme vivante, dévalant la pente d’une prairie au bras de son amoureux. Le spectateur peut alors se remémorer comment, lors de cette séquence d’idylle, Jeanne Moreau déclarait n’avoir pas peur de la mort, celle-ci « faisant partie du programme. ». Une fois ces images surimprimées disparues, le film fait entendre un soldat qui demande : « Quelqu’un réclame-t-il le corps ? Quelqu’un réclame-t-il le corps ? », dans une litanie que personne ne vient interrompre, le corps de Mata Hari continuant à pendre lamentablement. Ce corps de danseuse, corps de gourgandine, corps d’espionne, termine donc corps inerte. Ainsi, même ce fameux pouvoir du corps, que la femme détient comme une arme contre les hommes, paraît ici dérisoire.
Le cas de Sylvia Kristel est de même extrêmement ambigu. L’actrice, dans son rôle typique de belle plante sensuelle de la révolution des mœurs des années soixante-dix, assène à la nonne de sa prison de Vincennes: « Ma Mère, l’heure n’est plus à la pudibonderie ». Pourtant, tout le film construit symétriquement un discours bien plus stéréotypé sur l’éternelle femme fatale. Au début du film, lors d’un voyage en train, Mata Hari choisit de vivre une étreinte torride avec un bel inconnu. La scène est tournée comme une scène érotique soft. Au moment suprême, l’homme est tué par derrière d’une flèche empoisonnée et s’effondre sur le corps dénudé de la jeune femme terrorisée. Plus tard, cet épisode vaudra à Mata Hari une remarque ironique sur la petite mort qu’elle a littéralement infligée à son partenaire. Jouant de sa persona, l’actrice affirme à ceux qui s’offusquent de ses étreintes avec des inconnus que « l’hypocrisie mesquine » ne la touche pas, faisant ainsi se télescoper la liberté sexuelle avérée de la véritable Mata Hari et la liberté d’Emmanuelle. Cependant, tout se passe comme si Mata Hari-Krystel était une mante religieuse malgré elle — son coït ferroviaire achevé par la mort réelle de son partenaire ne pouvant être innocent. L’esthétique crépusculaire du film, avec ses tons tour à tour blafards et rougeoyants, le personnage de garce perverse de Fraülein Doktor, le style érotique « peau de bête » de certaines scènes de sexe… : tout concourt dans le film à projeter une atmosphère décadence fin de siècle. Enfin, l’avant-dernière séquence du film montre l’exécution de Mata Hari. Sylvia Kristel refuse le bandeau sur les yeux et la scène est construite sur un lourd suspense : roulements de tambours qui n’en finissent pas, gros plans sur le visage courageux de l’espionne, plans sur les militaires qui attendent la mort de la condamnée... On peut y voir la volonté de témoigner de la dignité de la belle espionne, mais on peut y déceler aussi une certaine complaisance à filmer la mise à mort de la sensuelle Mata Hari.
Contrairement aux deux films de 1964 et 1984, le film de 1931 escamote la mise à mort de l’espionne. Garbo, tombée finalement amoureuse du jeune Russe qu’elle avait dupé, s’est moralement rachetée. Mais elle ne devient pas pour autant une femme radicalement autre. Dans sa prison, s’interrogeant sur l’éventualité d’une autre destinée (aurait-elle pu devenir nonne ?), elle répond tranquillement par la négative : « Je suis comme je suis. ». Avant de se faire capturer, Garbo s’était rendue à l’hôpital pour visiter son jeune Russe devenu aveugle. Si elle apparaît comme une femme amoureuse et non plus comme une ironique femme de tête, la mise en scène accuse l’aspect « homme doux » du jeune infirme, dominé spatialement par la femme debout, qui le regarde comme un enfant diminué dont il faut prendre soin. Mata Hari-Garbo garde ainsi une position dominante au sein du couple. D’autant plus qu’elle propose à son amant, privé désormais de la vue, de devenir ses yeux. Ici, on voit comment l’actrice va au bout de ce renversement des logiques habituelles du cinéma classique : l’homme aveugle (émasculé ?) ne peut plus la contempler, et c’est elle qui s’affirme plus que jamais sujet du regard. Enfin, le film de Fitzmaurice, en laissant hors champ l’exécution de Mata Hari, laisse dans la tête du spectateur l’image d’une femme forte, rebelle aux hommes, assumant jusqu’au bout qui elle est — et non l’image d’une victime.
Il existe, depuis les années vingt, un grand nombre d’ouvrages consacrés à l’espionne mythique : romans populaires, témoignages des acteurs du drame, travaux d’historiens des moins fiables aux plus documentés. Tous prennent position sur la question de la culpabilité de Mata Hari, sur ses actes de trahison à l’égard de la France. L’immédiat Après-guerre, période instable qui débouche sur un nouveau conflit avec l’Allemagne, privilégie la thèse d’une Mata Hari dangereuse espionne au service de Guillaume II. Avec l’éloignement des deux Guerres mondiales, les historiens ont au contraire tendance à minorer les hauts-faits de la danseuse javanaise. Ils privilégient un portrait de femme affabulatrice, courtisane de la Belle Epoque qui se lance dans l’espionnage par dépit tandis que sa carrière de danseuse décline; une espionne peu efficace, vite encombrante et, au final, manipulée par des forces et des enjeux qui la dépassent. Les trois films que nous avons examinés ont donc tendance à reproduire ces successives orientations de l’historiographie.
Le personnage de Mata Hari est devenu par ailleurs un « véhicule » de choix pour imposer les stars féminines. On peut trouver paradoxal qu’une actrice hollywoodienne des années trente comme Garbo incarne une version de Mata Hari investie de bien plus de pouvoir qu’une star de la Nouvelle Vague ou qu’une star de la révolution sexuelle des années soixante-dix. Les Studios ont en effet cherché à figer la « Divine » dans des rôles de vamps, d’amoureuses malheureuses et de fallen women. La star en était d’ailleurs la première révoltée, si bien qu’après Mata Hari, elle chercha à imposer la production d’un film qu’elle contrôlerait en grande partie: ce fut La Reine Christine, consacré à la grande reine de Suède, femme de pouvoir et bisexuelle. Or, l’on constate que Garbo, même dans des projets qu’elle n’avait pas initiés comme Mata Hari, savait aussi imposer une image puissante de femme maîtresse d’elle-même.
Mais doit-on vraiment s’étonner que Jeanne Moreau et Sylvia Kristel n’incarnent pas des espionnes redoutables? Jeanne Moreau a pu représenter à partir d’Ascenseur pour l’échafaud une certaine incarnation de la femme moderne, en transgressant les normes de la photogénie, en exaltant une forme d’authenticité et de liberté dans le jeu. Mais comme l’a montré Geneviève Sellier, l’émancipation de l’égérie de la Nouvelle Vague, ce cinéma au « masculin singulier »[4], s’exerce exclusivement sur le terrain des relations amoureuses, loin de toute modernité sociale. Jeanne Moreau peut donc interpréter une Mata Hari sexuellement libre, tout en demeurant essentiellement une grande amoureuse, et certainement pas une femme de pouvoir.
Quant à l’incarnation de Mata Hari par Sylvia Kristel, elle est aussi conforme à la persona d’une actrice initialement ingénue libertine, prisonnière d’une plastique trop parfaite que le public ne se lassa pas de contempler, sans lui donner l’occasion de s’affirmer dans des rôles plus consistants.
Clara Laurent
[1]Michelle Coquilat, « Les femmes, le pouvoir et l’influence » (1983) in Odile Krakovitch, Geneviève Sellier, Eliane Viennot, Femmes de pouvoir : mythes et fantasmes, Paris, L’Harmattan, 2001
[2] « Plaisir visuel et cinéma narratif », traduit en partie dans CinémAction, 20 ans de théories féministes sur le cinéma, Paris, Corlet, 1993
[3] Sylvia Kristel, Nue, Paris, Le Cherche midi, 2006
[4] Geneviève Sellier, La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier, Paris, CNRS, 2005 (chapitre IX)
Paru dans CinémAction n°129, Femmes de pouvoir, sous la direction de Penny Starfield (2008) – D.R.